En 1929, la crise à propos de la « provencialisation » du Niçois atteint son apogée ; le 23 janvier Isnard écrivait au président de L’Acadèmia : « …Vous avez eu l’amabilité de me faire l’honneur de me demander de parler à notre société de l’œuvre du savant niçois J.-B. Vérany… Depuis, j’ai reçu de M. le secrétaire général de l’Acadèmia un avis m’informant que vous avez eu la bonté de fixer celle-ci au dimanche 27 janvier courant à 10 heures Il va sans dire que j’avais accepté cette date d’avance mais à la rédaction à peine polie du papier qui m’a été envoyé, j’avais cru deviner un mécontentement que je ne pouvais m’expliquer. Or, je viens d’être entièrement éclairé en lisant, non sans quelque étonnement, dans le numéro de L’Eclaireur de Nice du 22 janvier courant, que le même jour et à la même heure une conférence est organisée à Nice par la société provençale « le Caireu » dont M. le secrétaire de l’Acadèmia Nissarda est le président. M. Joseph Giordan est-il avant tout secrétaire général de l’Acadèmia Nissarda ou président du Caireu ? Je ne veux pas le savoir et je tiens absolument à rester étranger aux incidents regrettables que cette situation est de nature à faire naître… Je viens vous demander s’il ne serait pas convenable de supprimer tout simplement ma conférence. Moi je pense que oui… ».
De nouveaux incidents eurent lieu à l’Acadèmia entre les défenseurs de Nice et le clan des « Provençaux », c’est-à-dire des profrançais. Les propositions orthographiques d’Isnard furent finalement adoptées, mais ce dernier adressa le 30 novembre un courrier peu amène mais amplement justifié à Joseph Giordan, secrétaire général de l’Acadèmia ; en effet, avec son association le Caireu, ce dernier militait ouvertement pour la provencialisation de la langue niçoise : « Mon cher ami, Par l’attitude que vous avez prise hier soir dans la question de l’orthographe du Niçois, il m’a paru que vous aviez l’intention de faire cesser cet esprit de solidarité et de collaboration continue qui nous unissait et qui fut jusqu’ici féconde en résultats. Je n’ai jamais eu la prétention de vous imposer mon système et il vous était loisible de voter contre mais je ne vous cache pas qu’il m’a été très pénible de vous voir prendre la tête du mouvement provençal à l’Acadèmia, engager le premier la lutte et mener le combat pour essayer de faire adopter des formules provençales juste au moment où le « Caireu » fait publier que ses membres écriront désormais le Niçois avec l’orthographe Mistralienne pure. La position que vous avez prise me paraît d’autant plus étrange que vous n’écrivez pas en Niçois et que vous m’avez souvent dit que la question du système de l’orthographe vous importait peu. Elle crée dans tous les cas une fissure très regrettable dans notre bloc, plusieurs de nos collègues l’ont remarqué. Quoi qu’il advienne, je demeure plus que jamais fidèle à notre drapeau… ».
Joseph Giordan lui, en tant que « responsable des Bureaux » d’une grande banque française, à savoir la Société Générale, ne défendait pas le drapeau niçois, mais celui de la puissance occupante. Désormais, la scission entre les pro-Niçois et les tenants de la Provence, à savoir de la France, était inévitable. Pierre Isnard, excédé par la tournure que prenaient les événements, provoqua un terrible scandale à Nice en 1931, année où précisément se tenait au Musée Masséna une exposition sur l’annexion de 1860 ; homme d’esprit, il usa d’un stratagème dont le temps n’a en rien atténué la saveur. Grand collectionneur, Isnard était en possession d’une pièce historique inédite d’une importance capitale ; il la confia à L’Acadèmia dont il faisait partie, tout en la publiant dans L’Armanach (il en était co-directeur, avec Louis Cappatti). Le prétexte de cette publication était de prouver que l’orthographe de l’ancien Niçois correspondait bien à sa façon d’écrire.
Dans L’Armanach, le texte de présentation (l’original manuscrit que nous avons consulté est de la main même d’Isnard) est volontairement d’une extrême sobriété : « L’Armanach est heureux d’offrir à ses lecteurs, la primeur d’une page de Fenochio, relative à l’annexion de 1860, qui fait, cette année, l’objet d’une exposition au Musée Masséna. Nos lecteurs remarqueront que Fenochio orthographiait le Niçois presque à la façon de notre codirecteur Pierre Isnard. Au surplus, peu avant sa mort, l’abbé Pellegrini avait, lui aussi, constaté la nécessité de noter le son u, en surmontant cette lettre d’un tréma ». Mais en fait le tréma sur le u n’était que l’arbrisseau cachant une forêt de désagréables vérités : le texte était une page autographe de Fenochio, directeur du journal Le Nizzardo en 1860, dans laquelle il donnait du sentiment exprimé par les Niçois, au moment de l’annexion, une version diamétralement opposée à la thèse officielle… Le texte, que nous avons intégralement cité plus haut, démentait totalement tout ce que l’Empire, puis la IIIe République, à coups de célébrations, de falsifications diverses et de publications mensongères, tentait depuis soixante et un ans, d’ancrer dans la tête des Niçois. Au bas de l’article était dessiné un gros cougourdon bien ventru, allusion au fait que les Niçois avaient été roulés dans la farine, lors du plébiscite truqué…
Pierre Isnard, soutenu par Cappatti, était allé très loin en contestant habilement la thèse française au moment même où elle était célébrée par une exposition au Musée Masséna. Les hostilités étaient ouvertes et la direction de L’Acadèmia, issue de la bourgeoisie profrançaise, lui tira dessus à boulets rouges, comme autrefois les franco-turcs sur la ville. Son président était à l’époque Jean-Albert Roissard, baron de Bellet. Rappelons que la famille Roissard, contrairement aux apparences, n’était pas d’ancienne souche niçoise, mais originaire de Savoie ; le père du président, le baron François Alphonse, décédé en 1918, avait pourtant été élu député de Nice-Campagne en 1876 avec l’aide du journal séparatiste Il Pensiero ; très souvent, il faut le constater, la mémoire est inversement proportionnelle à la hauteur de la position que l’on occupe. A la suite de la publication « scandaleuse », qui ouvrait une énorme brèche dans la bonne conscience française, L’Acadèmia se divisa et la polémique s’étala dans la presse niçoise ; les journalistes, contrairement à ceux d’aujourd’hui, ne craignaient pas les vagues. On put lire dans le journal Le Caméléon du 29 mars 1931 :
-
« Sous la coupole niçoise, qui l’emportera des « Cappatistes » ou des « Belletistes » ? Le torchon brûle au sein de la docte académie. Le président est démissionnaire. Les membres du conseil de direction s’entre-déchirent. Et la toute prochaine assemblée générale s’annonce comme devant être tumultueuse au possible. Une réunion du conseil de direction se tint ces jours derniers. Le Dr Gasiglia la présidait. Brave homme certainement le docteur, mais quel foutu président ! Il ne parle pas, il ronronne. Lui seul s’entend et, probablement s’admire. Bref, le docteur Gasiglia avait convoqué d’urgence ses collègues : M. Roissard de Bellet continuait, en effet, à ne rien vouloir entendre pour retirer sa démission. Et tout ça par la faute de Fenochio… Isnard et Cappatti étaient là. Et aussi Garidelli et Reynaut. Blanchi, Fighiera, Berri et Fenoglio ne manquaient pas non plus… Le docteur-président donne lecture de la lettre que les deux coupables, Isnard et Cappatti, ont adressé à M. Roissard de Bellet. Lettre « très noble », souligne le président. Lettre « adroite » et sans plus eût dit Xavier-Emanuel s’il avait été là. Force fut après aux auditeurs d’entendre la réponse de M. Roissard de Bellet. Fin de non recevoir amicale, susurre le docteur Gasiglia. Rosserie boursouflée, aurait certainement lancé Me Buffon, s’il avait été présent à la réunion. Les premières passes s’engagent ainsi, presque courtoises. Ed. Berri ne va pas tarder à donner à fond, suivi par Reynaut. Deux membres du conseil de direction ont commis une faute (sic). Ils ont fait amende honorable… La porte doit s’ouvrir pour eux. Cependant, pour sauver les apparences, tout le conseil va démissionner. Et le Bureau, ainsi, fera peau neuve. Isnard et Cappatti bondissent. Ils veulent bien publier la prose de Fenochio, mais pour ce qui est de partir, rien à faire. Ils y sont, ils y restent ; Blanchi a horreur, lui aussi, de la démission collective. Enflant sa voix, il demande, il exige le départ des deux accusés, mais… que les autres ne s’en aillent pas, que diable ! Et Gasiglia, le docteur et Blanchi le luthier, ne manquent pas de signaler que les scrutins, même académiques, réservent parfois d’amères surprises. Isnard triomphe et avec lui Cappatti. Berri revient à la charge ; il fonce dur. La majorité le suit. Blanchi pâlit. Gasiglia reste silencieux. Démissionnera-t-on ? Non, car les deux compères goguenardent. Démissionnez si vous voulez, semblent-ils dire. Nous, nous restons. Et ils proposent même à Fenoglio le secrétariat de L’Acadèmia. C’en est trop. Le président, un instant démonté, reprend ses esprits ; il lève la séance. Et jusqu’au 18 avril prochain, les deux clans de l’Acadèmia se feront guerre âpre, sournoise, vilaine, peut-être ; qui l’emportera des « Cappatistes » ou des « Belletistes » ? Les paris sont ouverts… ». Puis vient le dernier paragraphe probablement ajouté par le rédacteur en chef du journal, afin de ne point trop mécontenter Monsieur le préfet : « Le Caméléon, toujours fidèle à sa devise, ne prend pas parti, mais… il trouve que c’est faire trop d’honneur à la prose maléfique de Fenochio – en dépit de son intérêt dialectal – que d’en avoir fait un « casus belli »… ». La République étant « une et indivisible », sa vérité l’était aussi, même si c’était une vérité vérolée, héritée du second Empire ; Isnard et Cappatti étaient donc des « coupables » et la prose de Fenoglio « maléfique » : voilà la plus belle preuve de l’intégrisme que faisait régner la IIIe République à Nice, par l’intermédiaire de ses agents locaux.
Entre-temps s’était posé un grave problème à la direction de L’Acadèmia ; devait-on rendre à Pierre Isnard la lettre originale de Fenochio qu’il avait confié à L’Acadèmia en toute confiance ? Entre honnêtes gens, la question n’aurait même pas dû se poser, mais la tentation de faire disparaître une preuve qui gênait le pouvoir fut la plus forte et on se la posa. Ce n’était plus une association niçoise, mais la forêt de Bondy. Isnard réclama le document avec fermeté, bien décidé à ne pas céder ; on tergiversa et le 19 avril eut lieu une séance houleuse à ce propos. Il semble que cette dernière incongruité fut la cause de la rupture définitive : Pierre Isnard adressa sa démission à L’Acadèmia, et cette fois la lettre était dactylographiée et glaciale : « Monsieur le président, J’ai le regret de vous adresser par la présente, ma démission de membre de L’Acadèmia, à la suite des incidents du dimanche 19 avril. Veuillez agréer etc. ».
-
Certains membres et non des moindres, refusèrent de forfaire à l’honneur et prirent parti pour Isnard. Le 25, Louis Cappatti, Stéphane Bosio, Eugène Ghis et Edmond Reynaud, déclarèrent que l’esprit régnant à L’Acadèmia ne correspondait plus à leur idéal niçois et adressèrent également leur démission. L’Acadèmia, en servant la France au lieu de servir Nice, n’était plus « Nissarda » que de nom ; elle s’était décapitée elle-même en perdant ses membres les plus éminents et les plus érudits. Le Camélon du 24 mai 1931 relata ainsi l’assemblée générale qui se tint après ces turbulences : « Dans la mare… L’Acadèmià Nissarda a tenu son assemblée générale. ça a bardé, rapport au séparatisme. Il y a eu des démissions notables et des abstentions significatives. Le communiqué à la presse était muet sur tout ça. Par contre, la liste des présents est édifiante. Elle énumère tout ce que Charlie Chaplin appellerait « les lumières de la Ville ». Citons : Le chevalier Totor de Cessole, C.F. Ingigliardi, Guillaume Borea, B. Visconti, Henry-Mari Bessy, M. Bavastro ! Avec de telles lumières, il n’y a pas à s’étonner si l’éclairage public coûte si cher à la Ville… ». Sans attendre, les démissionnaires Isnard, Cappatti, Ghis, Bosio et Reynaud décidèrent de fonder une revue de qualité véritablement niçoise dans laquelle ils pourraient publier leurs articles, sans être censurés ; le 1er juillet 1931 parut le premier numéro des Annales du Comté de Nice. L’affaire du document Fenochio n’était pas terminée et son légitime propriétaire le réclamait toujours. L’on s’avisa très vite en haut-lieu que Pierre Isnard était avocat et Louis Cappatti avoué… L’on battit donc courageusement en retraite. Pierre Isnard apprit par un courrier daté du 24 août que L’Acadèmia, ou ce qui en restait, baissait enfin pavillon ; le docteur Gasiglia, nouveau président de l’association en remplacement du baron de Bellet, était enfin revenu à la raison : « …Veuillez excuser le retard bien involontaire que j’ai mis à répondre à la lettre que vous m’avez adressé ces jours passés et signée de vous et de M. Cappatti au sujet de la réponse de M. le baron de Bellet à votre lettre concernant l’incident qu’avait soulevé la publication de la lettre de Fenoglio dans l’Armanach Niçard. J’estime que cette lettre vous appartient et doit vous être remise : j’ai prié M. Fenoglio di Briga, notre secrétaire, de la rechercher et de vous la faire tenir, vous la recevrez donc sous peu. Veuillez etc. ».






















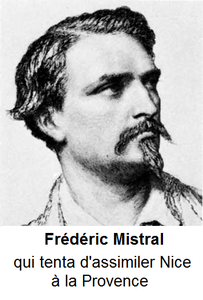 La « récupération » de Nice par la Provence, voulue par la France pour d’évidentes raisons politiques, a pris diverses formes ; la plus perverse fut le prétexte culturel. Sous couvert d’harmonisation l’on tenta en effet d’inféoder la culture et la langue niçoise au Félibrige provençal. Les subtilités dialectales étant affaire de spécialistes, je me bornerai à citer Eugène Ghis, qui dans l’Armanac de 1928 donne sur ce sujet un avis plus qu’éclairé : « Répéter ici que Mistral n’a pu faire entrer le langage nissart dans la grande compilation « Le Trésor du Félibrige », si ce n’est au prix de déformations radicales, m’attirera peut-être nouvellement le reproche de pédanterie. Peut m’en chaut… Les interpolations prétendues nissardes du « Trésor » trahissent outrageusement notre parler et on n’a pas idée, par exemple, au bord du Paillon, de phrases telles que celle-ci : « La bono armo de moun paire me disié » ; elle nous est cependant gratuitement attribuée au mot « amo » du glossaire. On peut se demander pourquoi Mistral, qui avait promis à A-L Sardou de donner aux Nissarts un vrai code de leur propre langage, en est arrivé, sous ce vain prétexte, à parsemer son travail d’une infinité de petites monstruosités dont la plupart prêtent franchement à rire. Or, voici ce qu’il en est. Mistral n’a pas pu réaliser sa téméraire promesse parce qu’il s’est butté, dans son entreprise, à deux difficultés insurmontables. Mistral n’a pas pu parler Nissart parce qu’il ne savait pas le premier mot de notre langue et parce que – afin de se documenter en l’espèce – il s’est adressé à des personnes dont j’ignore les noms et qualités, mais dont je puis dire qu’elles connaissaient le Nissart à peu près autant que Mistral lui-même. La seconde difficulté que Mistral a dû affronter c’est l’impossibilité matérielle de noter les sons du langage Nissart en se servant de la combinaison de fortune au moyen de laquelle les Félibres écrivent les patois provençaux. Entre les deux sortes de parler, l’opposition d’ordre phonétique est si complète, qu’on ne saurait la dissimuler sous une notation commune… On rencontre dans « le Trésor » presque autant d’inexactitudes qu’il y a d’expressions prétendument nissardes et ces inexactitudes ne sont pas purement superficielles ; les erreurs sont foncières… Mistral, en raison de son désir de résoudre le problème de la langue méridionale en un sens unitaire, n’a pas pu introduire dans le « Trésor du Félibrige » le Nissart sous son aspect propre.
La « récupération » de Nice par la Provence, voulue par la France pour d’évidentes raisons politiques, a pris diverses formes ; la plus perverse fut le prétexte culturel. Sous couvert d’harmonisation l’on tenta en effet d’inféoder la culture et la langue niçoise au Félibrige provençal. Les subtilités dialectales étant affaire de spécialistes, je me bornerai à citer Eugène Ghis, qui dans l’Armanac de 1928 donne sur ce sujet un avis plus qu’éclairé : « Répéter ici que Mistral n’a pu faire entrer le langage nissart dans la grande compilation « Le Trésor du Félibrige », si ce n’est au prix de déformations radicales, m’attirera peut-être nouvellement le reproche de pédanterie. Peut m’en chaut… Les interpolations prétendues nissardes du « Trésor » trahissent outrageusement notre parler et on n’a pas idée, par exemple, au bord du Paillon, de phrases telles que celle-ci : « La bono armo de moun paire me disié » ; elle nous est cependant gratuitement attribuée au mot « amo » du glossaire. On peut se demander pourquoi Mistral, qui avait promis à A-L Sardou de donner aux Nissarts un vrai code de leur propre langage, en est arrivé, sous ce vain prétexte, à parsemer son travail d’une infinité de petites monstruosités dont la plupart prêtent franchement à rire. Or, voici ce qu’il en est. Mistral n’a pas pu réaliser sa téméraire promesse parce qu’il s’est butté, dans son entreprise, à deux difficultés insurmontables. Mistral n’a pas pu parler Nissart parce qu’il ne savait pas le premier mot de notre langue et parce que – afin de se documenter en l’espèce – il s’est adressé à des personnes dont j’ignore les noms et qualités, mais dont je puis dire qu’elles connaissaient le Nissart à peu près autant que Mistral lui-même. La seconde difficulté que Mistral a dû affronter c’est l’impossibilité matérielle de noter les sons du langage Nissart en se servant de la combinaison de fortune au moyen de laquelle les Félibres écrivent les patois provençaux. Entre les deux sortes de parler, l’opposition d’ordre phonétique est si complète, qu’on ne saurait la dissimuler sous une notation commune… On rencontre dans « le Trésor » presque autant d’inexactitudes qu’il y a d’expressions prétendument nissardes et ces inexactitudes ne sont pas purement superficielles ; les erreurs sont foncières… Mistral, en raison de son désir de résoudre le problème de la langue méridionale en un sens unitaire, n’a pas pu introduire dans le « Trésor du Félibrige » le Nissart sous son aspect propre.  Dans le but d’assimiler tous les particularismes du Sud, une association fut créée le 21 mai 1854 par sept poètes provençaux, au « Castelet » de Font-Ségugne à Gadagne, près d’Avignon. Les autorités françaises ne furent pas étrangères à la mise en place du « Félibrige », mouvement culturel censé fédérer les pays du Sud autour de la Provence et donc de la France. S’étant étendu dans plusieurs provinces, le mouvement tenta son implantation à Nice en 1880. Quelques personnalités, pour la plupart étrangères à la ville ou y étant seulement nées (appartenant à la Société des Lettres, Sciences et Arts) fondèrent une « école félibréenne de la Maintenance de Provence », sous le nom « d’Escola Bellanda ». Afin de promouvoir ce cercle profrançais, le 5 mars 1882 la « Maintenance de Provence » tint son assemblée générale à Nice ; en présence de Frédéric Mistral Capouliè du félibrige, de Marius Bourrely, Syndic de la Maintenance et de centaines de « Félibres » provençaux, fut officiellement inaugurée l’Escola Bellanda. Mistral prononça un discours qui avait tout pour heurter les vrais Niçois : « Qui m’aurait dit alors que, peut-être trente ans après en revenant à Nice, je la trouverai française et de plus en plus provençale, avec sa vaillante « Ecole de Bellande » qui arbore dans l’azur de votre golfe merveilleux, le gai drapeau du Félibrige… Que toujours, belle Nice tu t’épanouisses au soleil, pour l’honneur de la Provence, pour la gloire de la France… ». Beaucoup de Niçois furent choqués par le fait qu’une association soit créée à Nice « pour l’honneur de la Provence et la gloire de la France » et que celle-ci porte le nom de « Bellanda », appellation évoquant l’ancien château de Nice, justement rasé par les troupes françaises et provençales… Les Niçois ne comprirent pas non plus pourquoi leur ville « devait s’épanouir pour l’honneur de la Provence et la gloire de la France », alors que la Provence et la France se servaient uniquement de Nice comme bouclier militaire aux frontières et que l’aide économique accordée par Paris était plus que chiche. Nice devait effectivement s’épanouir mais pour elle-même et au bénéfice des Niçois.
Dans le but d’assimiler tous les particularismes du Sud, une association fut créée le 21 mai 1854 par sept poètes provençaux, au « Castelet » de Font-Ségugne à Gadagne, près d’Avignon. Les autorités françaises ne furent pas étrangères à la mise en place du « Félibrige », mouvement culturel censé fédérer les pays du Sud autour de la Provence et donc de la France. S’étant étendu dans plusieurs provinces, le mouvement tenta son implantation à Nice en 1880. Quelques personnalités, pour la plupart étrangères à la ville ou y étant seulement nées (appartenant à la Société des Lettres, Sciences et Arts) fondèrent une « école félibréenne de la Maintenance de Provence », sous le nom « d’Escola Bellanda ». Afin de promouvoir ce cercle profrançais, le 5 mars 1882 la « Maintenance de Provence » tint son assemblée générale à Nice ; en présence de Frédéric Mistral Capouliè du félibrige, de Marius Bourrely, Syndic de la Maintenance et de centaines de « Félibres » provençaux, fut officiellement inaugurée l’Escola Bellanda. Mistral prononça un discours qui avait tout pour heurter les vrais Niçois : « Qui m’aurait dit alors que, peut-être trente ans après en revenant à Nice, je la trouverai française et de plus en plus provençale, avec sa vaillante « Ecole de Bellande » qui arbore dans l’azur de votre golfe merveilleux, le gai drapeau du Félibrige… Que toujours, belle Nice tu t’épanouisses au soleil, pour l’honneur de la Provence, pour la gloire de la France… ». Beaucoup de Niçois furent choqués par le fait qu’une association soit créée à Nice « pour l’honneur de la Provence et la gloire de la France » et que celle-ci porte le nom de « Bellanda », appellation évoquant l’ancien château de Nice, justement rasé par les troupes françaises et provençales… Les Niçois ne comprirent pas non plus pourquoi leur ville « devait s’épanouir pour l’honneur de la Provence et la gloire de la France », alors que la Provence et la France se servaient uniquement de Nice comme bouclier militaire aux frontières et que l’aide économique accordée par Paris était plus que chiche. Nice devait effectivement s’épanouir mais pour elle-même et au bénéfice des Niçois. 
 Toute la bourgeoisie, propagandiste de la puissance annexante, qui l’avait laissé croupir dans la misère, tout en l’honorant de baveux compliments, couvrit sa mémoire de fleurs, sans doute afin qu’elle soit mieux enterrée. Quelques-uns furent plus sincères ; Le Petit Niçois, entre autres, lui rendit un hommage mérité : « …Il appartenait à cette génération de forts qui préféraient porter la croix sur l’épaule plutôt que sur la poitrine. Aujourd’hui, las d’agir et non d’espérer, c’est à l’étude du Comté niçois qu’il appliqua son intellectualité et sa culture… ». Sappia disparu, le clan des notables stipendiés par la France prit les choses en main et la revue Nice Historique, bien que de bonne tenue, (seulement en ce qui concernait les sujets ne prêtant pas à polémique), véhicula sans vergogne les mensonges les plus éhontés sur le « rattachement » de 1860, comme elle fit l’impasse la plus totale sur la dictature instaurée à Nice en 1870 et 71 par le pouvoir français. Ceux qui se voulaient les « gardiens du Temple » niçois, laissèrent sans mot dire se détériorer les monuments rappelant la liberté de Nice, comme l’ancien Hôtel de ville et la statue de Garibaldi ; des journalistes de L’Eclaireur s’en émurent, notamment dans un article du ler janvier 1907 : « Maintes fois déjà nous nous sommes élevés contre le regrettable abandon dans lesquels les services compétents laissent certains points de la ville. Un des endroits les plus délaissés est assurément cette place Garibaldi, laquelle, quoi qu’en ait dit Jean Lorrain, n’est pas seulement réservée aux flâneries des transalpins, fraîchement débarqués dans notre ville. Cette place, que domine la noble prestance, statufiée en pur Carrare, de l’héroïque Garibaldi, est vraiment dans un déplorable état. Le bassin qui s’arrondit au milieu de la place aurait grand besoin d’un sérieux nettoyage… ». Les « Gardiens du Temple », faisant assaut de veulerie, ou montrant une parfaite inculture (à moins que ce soit une combinaison des deux) se livrèrent à une formidable falsification historique qui prit un tour encore plus forcené quand le fascisme italien commença à revendiquer Nice. Le prétexte était rêvé pour que le coq gaulois, masque la vérité sur la confiscation des droits de Nice. Le Conseil de rédaction de L’Acadèmia, composée alors des éléments que l’on sait, se réunit le 24 juin 1933 à la Villa Masséna, pour délivrer une belle déclaration patriotique de circonstance : « …Nous n’avons pas à affirmer notre indiscutable loyalisme envers la patrie française, que nos pères ont librement adopté en 1860 dans des conditions officielles et historiques, sur lesquelles il serait injurieux de revenir. Il faut donc qu’on sache bien en Italie que nous ne renierons jamais la signature de nos pères qui se conformèrent librement et par un vote unanime, aux décisions prises en 1860, et en plein accord par le gouvernement de l’empereur des Français Napoléon III et celui du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II… ».
Toute la bourgeoisie, propagandiste de la puissance annexante, qui l’avait laissé croupir dans la misère, tout en l’honorant de baveux compliments, couvrit sa mémoire de fleurs, sans doute afin qu’elle soit mieux enterrée. Quelques-uns furent plus sincères ; Le Petit Niçois, entre autres, lui rendit un hommage mérité : « …Il appartenait à cette génération de forts qui préféraient porter la croix sur l’épaule plutôt que sur la poitrine. Aujourd’hui, las d’agir et non d’espérer, c’est à l’étude du Comté niçois qu’il appliqua son intellectualité et sa culture… ». Sappia disparu, le clan des notables stipendiés par la France prit les choses en main et la revue Nice Historique, bien que de bonne tenue, (seulement en ce qui concernait les sujets ne prêtant pas à polémique), véhicula sans vergogne les mensonges les plus éhontés sur le « rattachement » de 1860, comme elle fit l’impasse la plus totale sur la dictature instaurée à Nice en 1870 et 71 par le pouvoir français. Ceux qui se voulaient les « gardiens du Temple » niçois, laissèrent sans mot dire se détériorer les monuments rappelant la liberté de Nice, comme l’ancien Hôtel de ville et la statue de Garibaldi ; des journalistes de L’Eclaireur s’en émurent, notamment dans un article du ler janvier 1907 : « Maintes fois déjà nous nous sommes élevés contre le regrettable abandon dans lesquels les services compétents laissent certains points de la ville. Un des endroits les plus délaissés est assurément cette place Garibaldi, laquelle, quoi qu’en ait dit Jean Lorrain, n’est pas seulement réservée aux flâneries des transalpins, fraîchement débarqués dans notre ville. Cette place, que domine la noble prestance, statufiée en pur Carrare, de l’héroïque Garibaldi, est vraiment dans un déplorable état. Le bassin qui s’arrondit au milieu de la place aurait grand besoin d’un sérieux nettoyage… ». Les « Gardiens du Temple », faisant assaut de veulerie, ou montrant une parfaite inculture (à moins que ce soit une combinaison des deux) se livrèrent à une formidable falsification historique qui prit un tour encore plus forcené quand le fascisme italien commença à revendiquer Nice. Le prétexte était rêvé pour que le coq gaulois, masque la vérité sur la confiscation des droits de Nice. Le Conseil de rédaction de L’Acadèmia, composée alors des éléments que l’on sait, se réunit le 24 juin 1933 à la Villa Masséna, pour délivrer une belle déclaration patriotique de circonstance : « …Nous n’avons pas à affirmer notre indiscutable loyalisme envers la patrie française, que nos pères ont librement adopté en 1860 dans des conditions officielles et historiques, sur lesquelles il serait injurieux de revenir. Il faut donc qu’on sache bien en Italie que nous ne renierons jamais la signature de nos pères qui se conformèrent librement et par un vote unanime, aux décisions prises en 1860, et en plein accord par le gouvernement de l’empereur des Français Napoléon III et celui du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II… ».